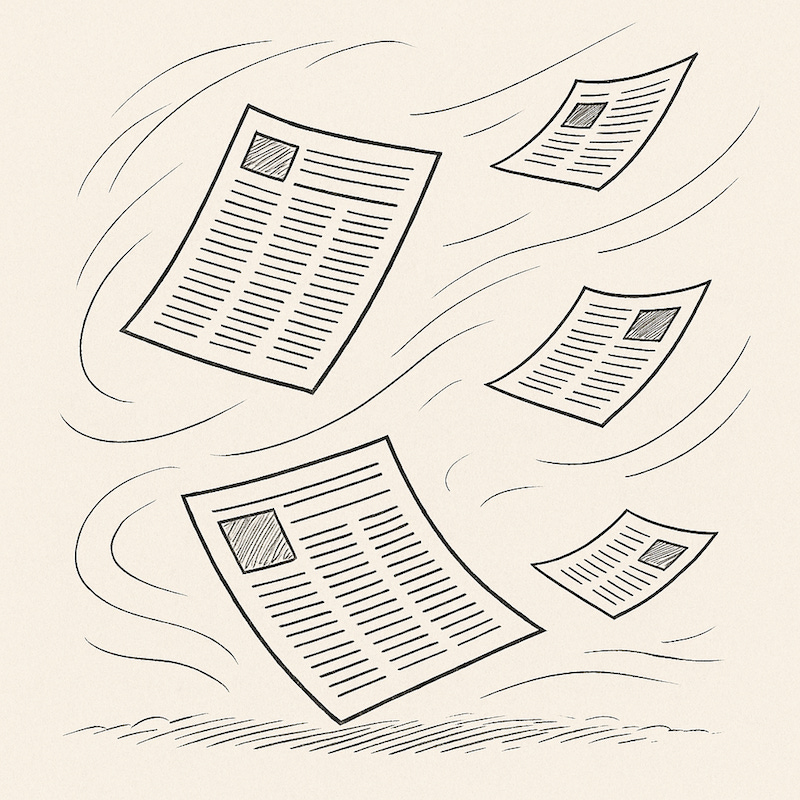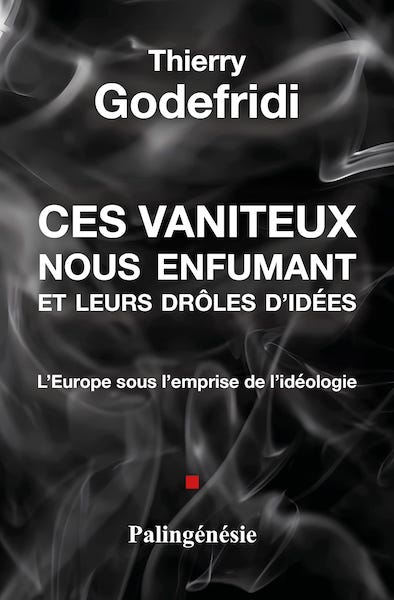Pauvre presse écrite francophone belge
La faute aux autorités, aux plateformes numériques et à l'IA ?
A l'annonce de la fusion entre les groupes de presse écrite francophone belge IPM et Rossel, les journalistes et les syndicats ont publié un communiqué dans lequel ils dénoncent « l’incapacité persistante des autorités politiques et de régulation, aux niveaux belge et européen, à mettre en place un cadre concurrentiel sain et équitable entre médias et plateformes numériques ». « Le temps presse, affirment-ils (sans intention apparente d'un jeu de mots). Sans action déterminée, le pillage des contenus par l’IA générative accélérera le déclin du secteur. » En bref, c'est la faute aux autorités, aux plateformes numériques et à l'IA.
Les auteurs du communiqué insistent sur la nécessité du pluralisme des médias, « un pluralisme réel et non de façade », et d'« une information diversifiée, de qualité et respectueuse de la déontologie, sur l’ensemble du territoire et sur toutes les matières [...], dans un contexte de désinformation galopante ». L'information, disent-ils, est un bien public. C'est aussi précis que l'intérêt général, cette notion fourre-tout qui selon qui la définit peut justifier toutes les atteintes aux libertés.
Les journalistes et syndicats de la presse officielle francophone belge ne devraient-ils pas balayer devant leur porte et s'interroger sur les dérives qui leur sont propres, à commencer par la baisse de qualité de l'offre par manque d'autocritique, frilosité éditoriale et entre-soi rédactionnel, et sur le modèle économique et la dépendance croissante aux aides publiques des maisons de presse ?
Un biais idéologique marqué
Pour parler d'une absence de pluralisme, « réel et non de façade », le premier reproche qui revient à l'égard de la presse écrite francophone belge, en particulier chez des lecteurs qui ne partagent pas sa vision, est son biais idéologique marqué (écologiste, égalitariste, pro-européen et mondialiste). Ce phénomène, que l'on retrouve dans d'autres pays européens, est particulièrement prononcé dans la presse francophone belge. Il s'explique par une homogénéité sociologique des journalistes (de par leur formation, leur cadre de vie urbain, leurs références culturelles), la polarisation croissante de leur production (dont certains thèmes ou points de vue sont ignorés), la disqualification automatique de certains courants d'opinion sous couvert de vigilance éthique ou de lutte contre « les » extrêmes.
A ce stade, la question se pose de ce que l'on entend par un journalisme réellement pluraliste dans un régime démocratique, pour autant que la Belgique le soit encore, ce que le journaliste belge Ivan De Vadder a contesté avec moult arguments dans son essai Wanhoop in de Wetstraat paru en 2022. (Quant à l'Union européenne, c'est une autre histoire.) Il est un autre élément qui intervient, le cordon sanitaire politique et médiatique appliqué à la belge, c.-à-d. différemment en Flandre et dans la partie francophone du pays, autour de l'extrême droite parlementaire, voire à la carte, sans la moindre procédure ni justification, dans le cas de certaines figures politiques, ostracisées en fonction des circonstances du moment. (Ça s'est vu à l'égard de la figure de proue de la N-VA en Wallonie lors des dernières élections législatives.)
A force de tentatives d'infantilisation du public francophone belge par souci de le préserver des idéologies qui vont à l'encontre de la doxa officielle, sa presse préserve-t-elle les « valeurs démocratiques » ou pratique-t-elle tout simplement une forme de censure déguisée qui nourrit le désintérêt à son égard ? Le refus du débat contradictoire renforce l'impression d'une presse enfermée dans ses dogmes, ce qui nuit à son originalité et à sa qualité (victimes du formatage et de la répétitivité des angles de vue), nuit à son rôle de force de réflexion et de contre-pouvoir et, finalement, dessert la démocratie.
Incriminer les plateformes numériques et l'IA comme boucs émissaires exclusifs des difficultés de la presse francophone belge, c'est aller à contre-courant de l'histoire. Ce n'est pas une première en Belgique francophone. Le président du Parti socialiste francophone n'avait-il pas imaginé en 2022 une Belgique sans e-commerce ? En ce qui concerne la presse écrite francophone belge, cela pose plusieurs problèmes, intellectuels, stratégiques et moraux. La numérisation du monde et l'IA sont des manifestations de l'évolution technologique. L'on s'adapte ou l'on reste en rade.
Un problème stratégique
Le problème de la presse écrite francophone belge n'est pas technologique, mais stratégique : tout comme elle a refusé de s'adapter à l'évolution de son lectorat, elle a été incapable de tenir compte de l'évolution technologique et de se réinventer en entrant en dialogue avec l'ensemble de ses lecteurs et en proposant des podcasts de qualité et des formats interactifs. Elle a préféré s'installer dans la dépendance aux aides publiques et la culture de la plainte plutôt que d'expérimenter et d'innover.
Ce n'est pas la technologie qui tue la presse, c'est l’inaction face à la technologie. L'incriminer, c'est une manière d'éviter les vraies questions. Pourquoi le journalisme francophone belge n'attire-t-il plus de jeunes esprits brillants ? (Ça ne date pas de hier, l'auteur de cet article pourrait personnellement en témoigner.) Pourquoi les rédactions refusent-elles le pluralisme d'opinions - « réel et non de façade » ? A quoi cela sert-il que les pouvoirs publics subventionnent l'uniformité et la médiocrité ? Une presse forte dans le monde de demain ne sera pas celle qui se plaint du changement, mais celle qui s’en saisit, restant fidèle aux principes qui l'ont fondée.
Il ne faut pas chercher loin les comparaisons. Il suffit de faire le parallèle entre la presse flamande et la presse francophone en Belgique : le contraste est révélateur. La presse flamande est globalement plus stable, diversifiée, plus centrée sur les intérêts du lecteur et rentable, ayant anticipé et embrassé tôt le virage numérique, empreinte d'une culture de service, de coopération et de gestion. La presse francophone pèche non seulement par son retard dans le domaine numérique, mais surtout par son homogénéité idéologique et son manque de diversité de ligne éditoriale, sa culture « moralisante » et défensive (quand il s'agit de ses propres intérêts), d'où son absence de renouvellement stratégique à tous égards.
Comment s'en étonner ? D'après un portrait datant de 2023, la majorité des journalistes se situent à la gauche du paysage politique et, parmi les moins de 35 ans, près d'un quart, à l'extrême gauche, ces tendances se trouvant apparemment renforcées chez les femmes. Près de trois quarts estiment être plus à gauche que le public auquel ils s'adressent. Le militantisme et la proximité partisane sont toutefois beaucoup plus marqués du côté francophone. Cela s'est indécemment manifesté chez les agités du cordon ombilical et sanitaire (asymétrique) lors des dernières élections législatives belges. N'allez pas chercher ailleurs que dans l'écart entre les attentes du public et l'offre rédactionnelle de la presse francophone belge la raison pour laquelle son lectorat s'en détourne.
(*) Soutenez ce site en achetant Ces vaniteux nous enfumant et leurs drôles d'idées – L'Europe sous l'emprise de l'idéologie (sur Amazon France avec livraison gratuite en Belgique et, sous condition, en France).