« J'écris pour savoir ce que je pense »
A l'âge des « perroquets stochastiques »
Kate Epstein est professeur agrégé d'histoire à la Rutgers University-Camden dans le New Jersey. Elle a publié le 7 mai 2025 sur le Substack Persuasion un article intitulé « We, Robots » dans lequel elle met en cause l'intégration croissante des technologies numériques dans le domaine éducatif et, en particulier, l'IA et ses répercussions négatives sur les capacités cognitives et émotionnelles des étudiants. Elle admet que l'IA excelle dans des tâches spécifiques telles que le calcul et le traitement de données mais s'oppose à l'idée que l'IA est en train de devenir plus intelligente que les humains.
Le discours alarmiste sur les capacités croissantes de l'IA donne une image erronée des limites de l'intelligence artificielle et de l'étendue de l'intelligence humaine. Epstein rappelle que les capacités de calcul et de traitement ne représentent qu'une partie de l'intelligence humaine, laquelle englobe aussi le raisonnement, le jugement et l'empathie. Elle avance que l'IA, malgré sa puissance dans son registre d'excellence, est dépourvue des dimensions essentielles de l'intelligence humaine et qu'elle rend les étudiants aussi peu intelligents qu'elle, parce qu'elle diminue leurs capacités de raisonner, de juger et de ressentir.
Peut-être avez-vous entendu parler d'étudiants universitaires incapables de lire des livres complets, mais sans doute ne vous rendez-vous pas compte du nombre d'étudiants qui savent à peine écrire. Et la situation ne fait qu'empirer, la prolifération des technologies numériques dans les salles de classe, avertit-elle, entraîne une grande déconnexion neuronale et une dégradation des standards éducatifs, d'où la baisse des capacités essentielles de lecture et d'écriture.
Epstein souligne l'importance de l'enseignement de ce qu'il est convenu d'appeler les « humanités », à savoir l'ensemble de disciplines qui étudient l’homme, sa culture, ses productions intellectuelles et artistiques, par exemple la philosophie, la littérature, les langues, la rhétorique, les arts, l'histoire, la religion. Le rôle de cet apprentissage est de comprendre la condition humaine, les valeurs, les idées et la culture qui ont façonné les sociétés à travers le temps et de développer la réflexion, la créativité et l'empathie, ce qu'il y a de plus riche et de plus complexe dans l'« humanité » - l'esprit et l'âme - et non une fonction plus étroite et plus simple réduite aux notions de travailleurs et de consommateurs. Il s'agit d'apprendre à penser avant que d'assimiler les connaissances liées à sa vocation.
Elle prend pour exemple sa propre discipline, l'histoire, laquelle exige l'analyse d'informations, qui sont à la fois écrasantes, insuffisantes, contradictoires et trompeuses, et une réflexion historique, qui implique une empathie imaginative, c'est à dire de se mettre à la place de personnes très éloignées de nous dans le temps et l'espace et d'essayer de comprendre comment et pourquoi elles ont donné un sens au monde comme elles l'ont fait. Redécouvrir la pensée d'Hammurabi ou de Solon n'est pas un processus foncièrement différent de découvrir celle d'un inconnu que l'on rencontre inopinément.
La menace que fait peser l'IA sur l'éducation humaniste réside dans une dénaturation du langage. En histoire, par exemple, fait remarquer Epstein, une grande part du travail intellectuel et émotionnel des chercheurs repose sur l’intuition, inconsciente et non verbalisée. Cette intuition se forme et se précise grâce au langage. Formuler une idée aide à la concevoir, et inversement. Ecrire ne sert pas seulement à s'exprimer, mais aussi à se découvrir, à affiner sa pensée. Pour paraphraser Boileau : comment bien concevoir quelque chose si les mots pour le dire ne viennent pas aisément ? On ne pense pas bien si l'on ne sait pas bien écrire. « J'écris pour savoir ce que je pense ».
La technologie ne suffit pas à l'épanouissement de soi. Certes, les techniques permettent de mieux vivre (leur développement a beaucoup apporté à l'humanité), mais non de bien vivre. Réfléchir, comprendre, vivre ensemble, aimer, tout cela et bien plus relève de la pratique des humanités et des arts libéraux, qui sont par d'ailleurs indispensables à la démocratie libérale. En effet, là où le calcul tend à déshumaniser, les humanités appellent à la tolérance, à la reconnaissance de l'autre comme égal en humanité, ce pour autant que les enseignants en toute conscience s’abstiennent d'inculquer à leurs étudiants leurs propres idéologies réductrices, « robot-lobotomisantes ». (*)
(*) Soutenez ce site et offrez Ces vaniteux nous enfumant et leurs drôles d'idées – L'Europe sous l'emprise de l'idéologie (disponible uniquement sur Amazon France avec livraison gratuite en Belgique et, sous condition, en France).




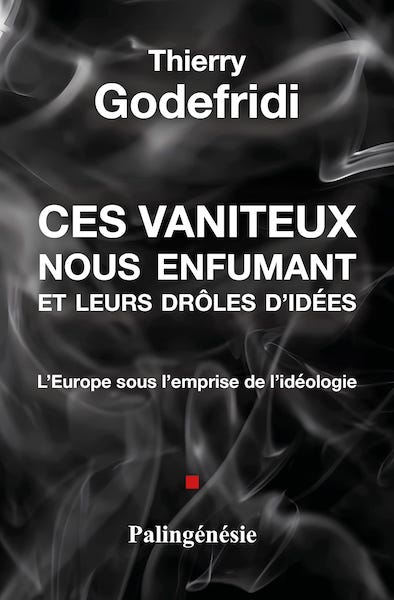
Raisonner, juger et ressentir effectivement sont ESSENTIELS et j'ai pu observer comme l'école passe à côté!
Triste que lire et écrire sont devenus des matières impossibles... et j'ai vu de vraies fautes de français - pas des coquilles - dans des travaux de profs de français!!
OUI, on doit apprendre à penser aux élèves et, comme disait mon père, historien: s'il ne restait qu'un cours, ce devrait être celui d'histoire.... il avait raison.